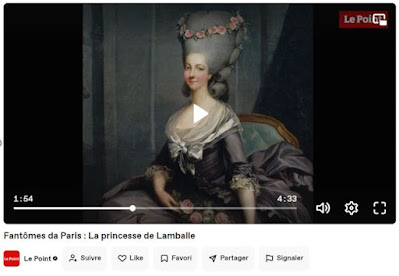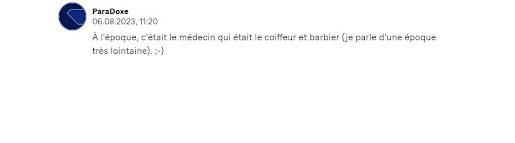Isabelle Laurens nièce de Blanche Laurence, aujourd'hui conseillée par deux avocats parisiens, Christophe Ayela et Ruth Gabbay, sait qu'elle a entamé un énième bras de fer avec "des procéduriers", "très puissants", "mais c'est mon devoir", souffle-t-elle, "pour que la justice puisse faire son travail". Désignée initialement comme légataire universelle sur les testaments de 2002 et 2003, cette psychologue de 57 ans, elle-même sans enfant, reconnaît avoir "peur" de s'attaquer à l'Église catholique qui a déjà "détruit une famille".
La nièce de Blanche Laurens n'en démord pas : ses proches et elle-même ont été victimes de captation d'héritage sous l'influence de trois personnes liées à l'Église catholique. Un avocat, un notaire et un secrétaire particulier, étrangers au cercle familial, auraient conduit la nonagénaire à modifier son testament au bénéfice des associations diocésaines de Paris et de Gap.
Isabelle Laurens confirme [...] que tout a été emporté. Photos, bijoux, objets, souvenirs ayant été débarrassés de l'appartement de la défunte, après sa mort, par les nouveaux propriétaires, à savoir les associations diocésaines désignées dans le testament de Blanche. Un testament remis en question par Me Ayela, qui aurait été, selon lui, "dicté" dans un dernier souffle de vie. [...]
Le patrimoine immobilier, comportant principalement 22 appartements bourgeois disséminés dans Paris, était estimé à 17 millions d'euros en 2013, "certainement le double aujourd'hui, ce qui suscite bien évidemment des convoitises", affirme Me Ayela. L'avocat décrit chez la vieille dame en 2012, au moment de la modification du testament, un état de "démence", assorti d’un syndrôme de Diogène, qui la maintenait alitée, la peau sur les os tandis qu'elle était assommée par les médicaments, "c'est clairement de l'abus de faiblesse, elle a été dépossédée de tout, s’indigne Christophe Ayela, quand ces gens rentrent dans la famille, c'est le loup dans la bergerie, ils vous dévorent".
Lorsque France3 la contacte, Isabelle Laurens revient de Ristolas, petit village niché au fond de la vallée du Queyras, où se trouve la maison de son grand-père. "Je me suis dit que peut-être de là-haut, il serait heureux de voir que j'ai rouvert les volets". Cette demeure, considérée comme le "berceau familial" des Laurens, Isabelle a dû payer pour la récupérer. Après des années de bagarre, elle raconte avoir été contrainte de racheter la part de l’association diocésaine de Gap qui en était devenue en partie propriétaire au décès de Blanche. Voilà qui fait du lieu un symbole de sa lutte depuis 20 ans pour que "l'honneur de la famille soit retrouvé".
Origine de la fortune des Laurens
Son grand-père, Marcellin, petit paysan des Alpes parti faire fortune dans le textile en Colombie au milieu du siècle dernier, a bâti l'immense patrimoine familial. Sa fille, Blanche, gérante durant trente ans de la pharmacie Ponsard à Paris avec les parents d'Isabelle, a ainsi hérité, comme ses deux frères, d'un capital monstre. Mais elle n'a pas d'enfant et désigne sa nièce comme héritière dans un premier testament en 2002. Le tissu familial est dépeint comme uni. Tout le monde logeait dans l'immeuble cossu de la rue Edmond-About," je vivais au-dessus de chez ma tante au 5ᵉ, mes parents au 4ᵉ, mon oncle au troisième et moi au 6e", raconte Isabelle, qui a vu débarquer des inconnus dans la vie de Blanche. Au début, elle ne se rend pas compte du va-et-vient tandis que les visiteurs prennent peu à peu le contrôle sur sa tante, "une mainmise totale, à la fois sur son patrimoine, son intimité, sa santé et l'accès à sa famille qu'elle avait de moins en moins". Désemparée, Isabelle n’a pas les clés, trouve systématiquement porte close, son père et son oncle, eux aussi âgés, paniquent. "Ces gens ont mis des rideaux occultant aux fenêtres, pour encore mieux l’isoler, insiste Christophe Ayela, c'est un phénomène d'emprise". Alors, "comme le majordome dans l'affaire Bettencourt", explique l'avocat, Isabelle Laurens se décide, les rares fois où elle le pourra, à faire des photos et à enregistrer des conversations qu'elle produit aujourd’hui dans son dossier.
Décès de Blanche Laurens
Le 7 juin 2012, Blanche Laurens aurait ainsi dicté son dernier testament au sein de l’office notarial d’Albert Collet. Après avoir alerté les services sociaux et médicaux compétents, c'est vers le juge qu'Isabelle et son père Jean finissent par se tourner vers le juge pour demander la mise sous tutelle de Blanche." La vieille dame décédera le 26 janvier 2013 à l'hôpital, juste avant l'audience, expose Me Ayela, sans que la famille soit prévenue de son décès". Il pointe cependant un détail : "en revanche, on retrouve dans le dossier médical hospitalier, la carte de visite de l'avocat de Blanche Laurens présenté comme la personne à prévenir en cas d’urgence ".
Monseigneur Di Falco
Un autre détail troublant vient titiller Isabelle et ses avocats. La fortune de Blanche a été léguée à l’association diocésaine de Paris et de Gap, dont autrefois le médiatique Jean-Michel Di Falco était le dirigeant en 2013. Quatre mois avant la rédaction du dernier testament de Blanche Laurens, une société civile immobilière de Gap et d’Embrun est immatriculée au tribunal de commerces. Structure détenue à 98% par l’association diocésaine de Gap dont Jean-Michel Di Falco est le président expliquent nos confrères. « Les conseils d’Isabelle Laurens voit dans cette création une manœuvre frauduleuse destinée à la captation de l’héritage de sa tante ».
Après avoir organisé un concours d'architectes, Di Falco procède à partir des années 2012-2013 à plusieurs rénovation au sein du diocèse mais également au sein de sa résidence personnelle rattachée au diocèse. Selon le JDD, Jean-Michel di Falco "menait grand train", faisant installer un parquet haut de gamme dans sa maison, construire un siège épiscopal tout neuf, recevant somptueusement, se déplaçant dans toute la France. L'évêque était entouré d'une "intendance digne d'un ministre", rapportent nos confrères : une trentaine de salariés sous ses ordres ! Directeur de cabinet, secrétaire mais aussi cuisinier, jardinier et tutti quanti.
Suite aux transferts des biens et des liquidités en 2015, la SCI se verra dotée de plus de 18 millions d’euros. Lors de l’inauguration du centre diocésain, Monseigneur Di Falco précisait dans son discours que c’est « grâce à un legs » que tous les travaux avaient pu être réalisés.
Mis en cause par la famille Laurens, l'homme d'Église, fondateur de la chaîne KTO, a réagi par communiqué sur son compte LinkedIn :"j’ai été contacté, je crois en 2012, par un notaire, ou un avocat, je ne saurais l’affirmer avec certitude, m’informant que les diocèses de Paris et de Gap allaient bénéficier d’un legs important à partager. Ce legs, composé principalement d’immeubles et d’appartements situés à Paris, a été reçu sans que je n'aie jamais rencontré ou connu personnellement la bienfaitrice à l’origine de cette disposition." Ce qui dérange Me Ayela dans cette déclaration, c'est qu'en 2012, Blanche Laurens était encore en vie. Il en conclut donc qu’il y a eu "violation de la confidentialité du testament".
Epilogue
Aujourd'hui Isabelle quinquagénaire se montre usée. Au fil de ces années de bataille, elle a vu sa famille de disloquer, a perdu sa mère, son oncle, son père, qui a "beaucoup souffert de tout ça" et se retrouve aujourd'hui bien seule. A présent, Blanche Laurens repose au cimetière à l’entrée du village et Isabelle pourra désormais se recueillir plus souvent sur sa tombe. "Il a fallu attendre 2022 pour que le nom de ma tante soit gravé dans la pierre du caveau familial, ils ne s'en sont même pas occupés", déplore-t-elle dans une émotion contenue. En effet, six ans après le décès de Blanche Laurens, l'association diocésaine n'avait même pas pris la peine de faire inscrire son nom sur le caveau familial.
 |
| ©Isabelle Laurens |
Dans l'immeuble du XVIe arrondissement où Isabelle Laurens réside toujours, l'appartement de Blanche sa défunte tante, est désormais occupé par le locataire de l'association diocésaine.
«C'est écœurant de voir qu'aujourd'hui, tout le monde se défile. On se renvoie la patate chaude. (...) Au lieu de faire un mea culpa et d'essayer de réparer le mal qui a été fait, aujourd'hui ces gens-là persistent et signent». La nièce de Blanche Laurens et ses proches espèrent une condamnation des personnes suspectées d'avoir abusé de la faiblesse de la défunte.
source:
La honte totale.
Hommes d'Eglise catholique, connaissez-vous le châtiment d'Héliodore ?